Jusqu’à récemment, bon nombre de discours sur les peintures murales romaines reposaient sur des problèmes stylistiques liés à la chronologie et à la typologie. Bien que les résultats aient été, de toute évidence, plus analytiques que ceux obtenus par les dilettantes et les connaisseurs, ils ont néanmoins décontextualisé les peintures, les privant de leur signification iconologique.
La théorie d’Auguste Mau, qui soutient une évolution successive des peintures murales de Pompéi à travers quatre styles, tend à incarner l’exemple le plus tenace de l’approche typologique (fig. 1–4). Ultérieurement, des auteurs ont construit leurs carrières à partir de cette thèse en décryptant d’autres sous-groupes à l’intérieur de chacun des quatre styles, censés représenter l’évolution de toute la peinture murale romaine des origines à la fin du premier siècle apr. J.-C. Ironiquement, les noms donnés aux quatre styles par Auguste Mau : le style des incrustations, le style architectural, le style ornemental et le style fantastique, ont moins bien résisté dans l’usage que l’ordre numérique correspondant, actuellement utilisé pour les désigner. Par exemple, le style architectural est maintenant généralement connu sous le nom de deuxième style. À plusieurs égards, la préférence pour l’ordre numérique comporte maints avantages car elle nous éloigne de la notion selon laquelle chaque style serait homogène d’un point de vue formel ou iconographique. La terminologie de d’Auguste Mau a été choisie dans le but d’attribuer une caractéristique type à chaque style. Malheureusement, non seulement, ce choix n’était pas assez représentatif, mais créait aussi des distinctions erronées entre les quatre styles. Le deuxième style comporte, en effet, un grand nombre de références architecturales, or il contient également beaucoup de motifs figuratifs, ornementaux et fantastiques. Le quatrième style, en plus d’être tant fantastique qu'ornemental, fait aussi appel à de nombreuses références architecturales.
Contrairement aux défenseurs des approches typologiques récurrentes, les historiens-sociologues ont, depuis les années 1980, eu recours aux peintures murales romaines pour décrire certains aspects de la société romaine. Généralement, ils ont centré leur étude sur la projection et la réception du statut social de l’individu, définies par les peintures murales et leur localisation dans la maison. Les pionniers dans ce domaine avaient été clairvoyants mais avaient, en quelque sorte, émis des réserves sur leurs conclusions. Les auteurs suivants, cependant, ont utilisé ces travaux sans tenir compte des mises en garde qui les accompagnaient. Le résultat de cet usage erroné, spécialement dans des articles courts, est une version récurrente de la société romaine qui relève plus une caricature que d’une réelle caractérisation. La caricature utilise la peinture murale per se comme une preuve de luxe symptomatique du désir hédoniste du propriétaire d’imiter les somptueux ornements de la culture grecque et hellénistique. Cet emploi traduit, à son tour, de manière symptomatique, la dégénérescence des valeurs traditionnelles romaines issues du stoïcisme dans les peintures murales et répond aux désirs du nouveau riche, uniquement guidé par le besoin d’exhiber son statut social. Cette vision enlève aux peintures murales toute signification inhérente qu’elles auraient, un jour, pu contenir. Cette considération présuppose que les propriétaires avaient une conception de la décoration d’intérieur gouvernée par l’hédonisme et non par la force symbolique du décorum. Il est également des plus étranges que cette conception de la société romaine et que cette interprétation des peintures murales soient le fruit des années 1980 et 1990. Cette époque est généralement connue ou caricaturée de nos jours comme le berceau d’une société du « moi d’abord », obnubilée par la poursuite du luxe et de l’opulence.
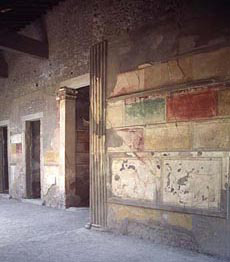 1
1
|